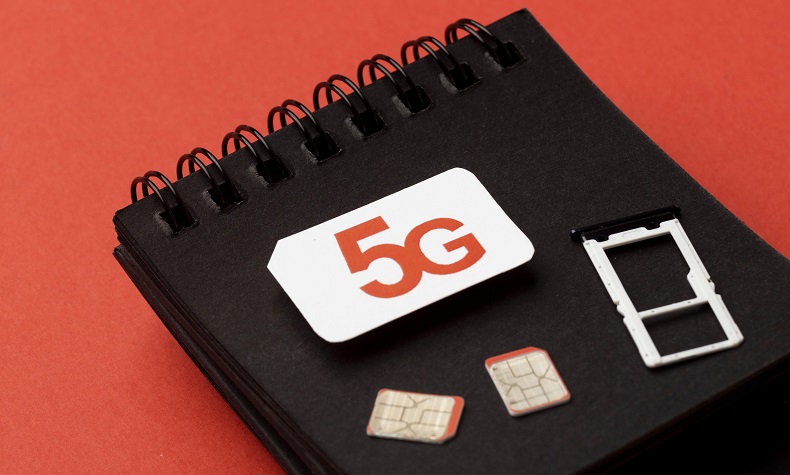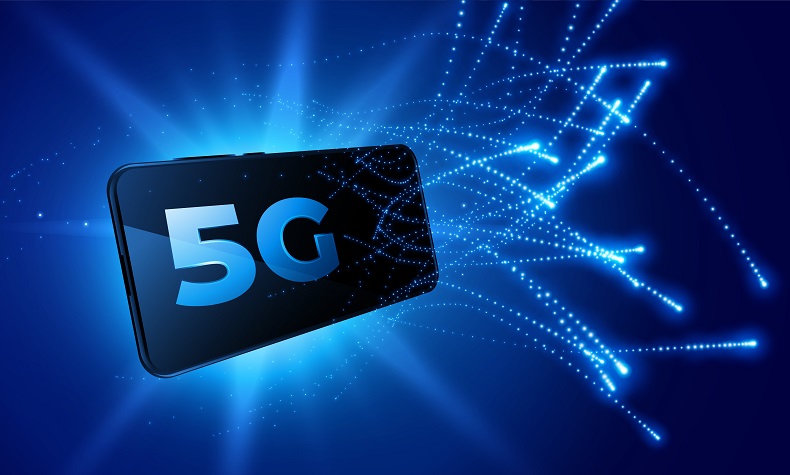Par Jean-Michel Huet, Marouane Znagui et Axelle Laplaze, BearingPoint
Face à l’accélération de la digitalisation des services financiers, aux exigences croissantes en matière de conformité, et à la nécessité d’une inclusion plus large des populations dans les systèmes formels, les autorités de supervision africaines sont confrontées à un double impératif : renforcer la stabilité financière tout en soutenant l’innovation. Dans ce contexte, les technologies RegTech (Regulatory Technology) et SupTech (Supervisory Technology) représentent des leviers essentiels pour moderniser la régulation et la supervision, avec des retombées concrètes et prometteuses sur le continent.
Ces outils technologiques transforment les méthodes traditionnelles, manuelles et fragmentées, en des approches automatisées, interopérables et axées sur les données. Sur le continent africain, où les contextes opérationnels sont variés et les dynamiques d’innovation particulièrement fortes, ces technologies offrent une opportunité unique d’optimiser la gouvernance du secteur financier.
Elles permettent de répondre plus efficacement aux défis de transparence, de réactivité et d’équité, tout en soutenant l’inclusion financière de populations historiquement éloignées du système bancaire formel. Loin d’être un simple effet de mode, la RegTech et la SupTech s’imposent désormais comme des piliers d’une régulation souveraine, proactive et alignée avec les ambitions de transformation numérique portées par de nombreux États africains.
Les RegTech (Regulatory Technology) désignent les solutions technologiques développées pour permettre aux institutions financières de mieux se conformer aux exigences réglementaires. Elles englobent un large spectre d’outils allant de la vérification automatisée de l’identité des clients (KYC) à la détection de transactions inhabituelles (AML/CFT), en passant par la génération de rapports réglementaires ou la surveillance des risques opérationnels. Grâce à des technologies telles que l’intelligence artificielle, le machine learning, la biométrie ou encore les API ouvertes, les RegTech permettent d’automatiser et de fiabiliser les processus de conformité, tout en réduisant les coûts et les délais.
Les SupTech (Supervisory Technology), quant à elles, s’adressent aux autorités de régulation et visent à moderniser les outils de supervision. Elles permettent de collecter et d’analyser de grands volumes de données issues des établissements régulés, de détecter des anomalies en temps réel, d’anticiper les risques systémiques et de visualiser dynamiquement des tendances. L’objectif est de passer d’une supervision rétrospective à une supervision préventive, appuyée sur des données granulaires, fiables et exploitables. Certaines solutions intègrent aussi des mécanismes de scoring, de cartographie des risques ou d’automatisation des processus d’inspection.
Si ces technologies ont émergé initialement dans les pays du Nord, leur appropriation en Afrique donne lieu à des trajectoires innovantes, souvent plus agiles, centrées sur l’efficacité opérationnelle et l’impact terrain. De nombreuses autorités africaines conçoivent ou adaptent des outils pensés pour répondre aux dynamiques locales : diversité des modèles financiers, pluralité des acteurs régulés, écosystèmes numériques en pleine croissance.
Ce pragmatisme technologique conduit à des innovations sobres, ciblées et résilientes, qui trouvent leur force dans leur capacité à s’ajuster à des environnements variés. Il en résulte une réelle capacité d’inspiration au niveau international, tant sur le plan technique que méthodologique. En misant sur l’interopérabilité, la collaboration interinstitutionnelle et le développement de compétences locales, les régulateurs africains contribuent activement à redéfinir les contours d’une supervision numérique plus inclusive, durable et souveraine.
L’Afrique à l’avant-garde : panorama approfondi des initiatives SupTech
La montée en puissance de la SupTech sur le continent africain se manifeste par une diversité d’initiatives structurantes, qui témoignent d’une transformation profonde dans la manière dont les régulateurs exercent leur mission. Ces projets s’inscrivent dans une dynamique de modernisation des systèmes de supervision, en lien étroit avec les ambitions de souveraineté numérique, de transparence accrue et de gestion proactive des risques.
Au Rwanda, la Banque Nationale du Rwanda (BNR) a déployé une plateforme SupTech interconnectée aux systèmes bancaires des établissements régulés. Cette infrastructure permet la collecte automatisée de données financières quotidiennes, mensuelles ou sur demande, tout en intégrant des mécanismes de validation automatique de la qualité des données. Un moteur analytique, couplé à un tableau de bord interactif, facilite la visualisation des indicateurs de risques : ratios de liquidité, niveaux de fonds propres, expositions sectorielles, etc. L’outil permet également de segmenter les données par taille d’établissement ou type d’activité, renforçant ainsi la capacité d’analyse différenciée. Cette initiative, lancée dans le cadre d’une stratégie nationale de transformation digitale, s’est accompagnée d’un volet formation destiné aux superviseurs, pour assurer une appropriation pleine des outils.
Au Ghana, la Bank of Ghana a déployé la solution ORASS (Operational Risk Assessment SupTech System), une plateforme modulaire intégrant plusieurs briques fonctionnelles : gestion des demandes de licence, suivi du cycle de vie des établissements régulés, analyse des indicateurs prudentiels et pilotage de la conformité. Grâce à l’utilisation d’outils tels que Power BI, l’interface permet de générer des alertes automatiques en cas de dépassement de seuils critiques, de visualiser l’historique des interventions de la banque centrale, et d’évaluer en continu la solidité financière des institutions supervisées. La co-construction de la plateforme avec les départements techniques et métiers a permis d’ancrer durablement l’usage de la SupTech dans les pratiques quotidiennes de supervision.
Au Mozambique, la banque centrale a fait le choix d’un développement endogène, en partenariat avec des développeurs locaux et des institutions universitaires. Le système mis en place cible en priorité les besoins essentiels : centralisation des données de reporting, alertes automatisées sur les ratios de solvabilité et de liquidité, et cartographie géographique des zones d’intervention. Il intègre également un module de suivi des délais de transmission de données, ce qui renforce la discipline réglementaire et la réactivité. Bien que techniquement plus simple, cette solution illustre une démarche souveraine, reposant sur la maîtrise des outils, l’adaptation au contexte national et l’implication des acteurs locaux.
Au Nigeria, la Central Bank of Nigeria pilote le développement d’un datalake financier national, une plateforme d’agrégation massive des données issues de banques, fintechs, établissements de microfinance, opérateurs de mobile money, et autres institutions régulées. Ce système vise à permettre une analyse transversale et en temps réel des dynamiques financières à l’échelle nationale. Il permettra par exemple de détecter automatiquement les schémas de transactions atypiques, d’identifier des poches de vulnérabilité, et d’ajuster les politiques de supervision en fonction des signaux émergents. Ce projet structurant repose sur une gouvernance multipartite, mêlant financement public, soutien de partenaires techniques internationaux et mobilisation d’expertises locales.
Ces cas illustrent la diversité des chemins empruntés par les régulateurs africains pour construire des écosystèmes SupTech performants. Au-delà des différences technologiques ou budgétaires, le fil conducteur réside dans la pertinence contextuelle des solutions adoptées, leur alignement avec les priorités nationales, et la capacité des institutions à s’approprier durablement les outils. L’Afrique se positionne ainsi comme un modèle émergent de la supervision numérique, à la fois innovant, résilient et inspirant pour d’autres régions du monde.
La RegTech au service d’une conformité intelligente et d’une inclusion renforcée
Pour les acteurs financiers africains, notamment les banques, les établissements de microfinance et les fintechs, les RegTech représentent bien plus qu’un simple levier de conformité. Elles offrent une opportunité stratégique d’alléger la charge réglementaire, d’optimiser les processus internes, de réduire les coûts liés aux audits et contrôles, et de renforcer la transparence vis-à-vis des régulateurs comme des clients finaux. En automatisant certaines tâches critiques (KYC, surveillance des transactions, reporting), les institutions financières peuvent non seulement améliorer leur efficacité opérationnelle, mais aussi élargir leur base clientèle, notamment dans les zones peu desservies.
Au Nigeria, l’interconnexion entre le système d’identité biométrique national (BVN – Bank Verification Number) et les bases clients des établissements financiers constitue un exemple emblématique. Ce dispositif permet de valider l’identité d’un client en quelques secondes, de prévenir les fraudes liées à la duplication des comptes, et de tracer les opérations suspectes sur l’ensemble du système bancaire. Il constitue un socle pour le développement de services financiers numériques sécurisés, en particulier pour les populations jusque-là exclues du système bancaire formel. Grâce à cette infrastructure, l’ouverture de comptes à distance a été massivement facilitée, tout comme l’accès au crédit ou aux produits d’épargne pour les citoyens sans historique bancaire traditionnel.
En Afrique de l’Est, des opérateurs fintech comme Tala ou Branch proposent des prêts instantanés via mobile, en s’appuyant sur des algorithmes de scoring alternatifs. Ces modèles analysent des données non financières (historique de paiement de services publics, données de téléphonie, comportement sur les applications mobiles) pour évaluer le risque client. Ces scores, générés automatiquement par des plateformes RegTech, sont compatibles avec les exigences prudentielles locales et permettent un reporting régulier aux régulateurs. Ce modèle d’analyse alternative a ouvert la voie à une inclusion massive de micro-emprunteurs, souvent exclus du système bancaire classique faute de garanties ou d’antécédents formels.
Au Sénégal, une initiative pilote soutenue par la BCEAO vise à automatiser le reporting réglementaire des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD), un secteur particulièrement dense et hétérogène dans l’espace UEMOA. Le projet repose sur un outil numérique qui permet aux SFD de structurer et transmettre leurs états financiers de manière standardisée et automatisée. Ces données sont directement intégrées dans les plateformes de supervision de la BCEAO, ce qui réduit drastiquement les erreurs de saisie, accélère le traitement des informations et améliore la qualité des décisions réglementaires. Ce type de solution participe à structurer durablement un secteur essentiel pour le financement de l’économie informelle.
Ces cas démontrent que la RegTech est non seulement un outil puissant de conformité, mais aussi un catalyseur d’innovation inclusive. En rendant la réglementation plus accessible et les processus plus agiles, elle permet aux acteurs du secteur financier de répondre aux besoins de segments de marché traditionnellement négligés, tout en renforçant la résilience et la transparence des systèmes financiers africains.
Facteurs clés de succès pour une mise à l’échelle réussie
La montée en puissance des initiatives RegTech et SupTech sur le continent africain repose sur plusieurs facteurs déterminants, mis en évidence à travers les projets emblématiques déjà déployés et les retours d’expérience des institutions concernées. Une mise à l’échelle réussie ne dépend pas uniquement de la technologie choisie, mais d’un écosystème cohérent, mobilisé et bien coordonné autour d’objectifs partagés.
Gouvernance claire et leadership institutionnel : les projets les plus aboutis sont souvent portés par une vision stratégique solide, traduite dans des feuilles de route nationales de transformation numérique, d’inclusion financière ou de réforme de la supervision. Par exemple, la plateforme de la Banque Nationale du Rwanda s’inscrit dans un cadre politique de digitalisation élargie à l’ensemble de l’administration publique. Un leadership affirmé au plus haut niveau, couplé à une coordination interinstitutionnelle, permet de lever les silos et de sécuriser les arbitrages nécessaires.
Standardisation des données et interopérabilité : une supervision efficace nécessite des formats normalisés, des dictionnaires de données unifiés, des protocoles d’échange robustes et des mécanismes d’intégration automatisée. Le Ghana et le Rwanda, en instaurant des référentiels uniques de données réglementaires, ont considérablement amélioré la qualité et la régularité du reporting. Cette standardisation facilite aussi l’analyse comparative entre institutions et l’automatisation de la supervision.
Investissement dans les compétences humaines : la réussite d’un projet RegTech ou SupTech dépend fortement de la capacité à mobiliser des talents pluridisciplinaires : spécialistes des données, économistes, juristes technophiles, ingénieurs systèmes. La Bank of Ghana, par exemple, a formé en interne des superviseurs à la visualisation de données, à la gouvernance de l’information et à la gestion de projet agile. Les partenariats avec les universités locales ou les incubateurs technologiques jouent également un rôle clé dans la montée en compétences durable des équipes.
Approche collaborative et inclusive : l’implication des acteurs financiers (banques, SFD, fintechs) dès les premières phases du projet garantit une meilleure appropriation et une adaptation plus fine aux besoins du terrain. Dans le cadre d’ORASS au Ghana, les utilisateurs finaux ont participé à la définition des indicateurs clés et à l’organisation des modules, ce qui a favorisé une adoption fluide de l’outil. Les phases pilotes, les itérations successives et le feedback continu sont autant de leviers de réussite.
Accès au financement et mobilisation des partenaires : la mise en œuvre de solutions technologiques ambitieuses peut nécessiter des ressources financières importantes. Plusieurs projets africains combinent des financements domestiques (budgets publics ou contributions des régulateurs) avec des appuis extérieurs (Banque mondiale, BAD, FSD Africa, UNCDF, etc.). L’ingénierie financière repose souvent sur des montages hybrides et une logique de long terme, intégrant maintenance, évolutivité et renforcement des capacités.
Ces facteurs combinés créent les conditions d’une transformation durable et cohérente. Ils permettent de dépasser la logique de projet pour inscrire la SupTech et la RegTech dans une véritable stratégie de modernisation institutionnelle, adaptée aux spécificités africaines et porteuse de valeur pour l’ensemble de l’écosystème financier.
Le rôle moteur des institutions régionales et panafricaines
L’essor de la RegTech et de la SupTech en Afrique peut être considérablement amplifié par une coordination régionale plus forte. Les institutions de supervision sous-régionales, les communautés économiques régionales (CER) et les acteurs panafricains jouent un rôle stratégique dans l’harmonisation des approches réglementaires, la mise en commun des ressources et la diffusion des bonnes pratiques.
Des initiatives structurantes émergent progressivement. Par exemple, au sein de l’UEMOA, la BCEAO explore des pistes pour mettre en place des plateformes régionales de supervision numérique ainsi que des « bacs à sable réglementaires » partagés. Ces environnements permettent de tester en conditions réelles des innovations technologiques, dans un cadre sécurisé, et avec un alignement interétatique renforcé. La CEMAC suit une logique similaire, en intégrant les enjeux de supervision digitale dans sa feuille de route régionale pour l’inclusion financière et la stabilité du système bancaire.
Au-delà des expérimentations, la constitution de réseaux d’échange entre autorités de régulation — qu’il s’agisse de réunions techniques, de groupes de travail thématiques ou de plateformes collaboratives — s’avère essentielle. Ces espaces favorisent la mutualisation des référentiels (dictionnaires de données, normes API, standards de qualité), accélèrent la montée en compétence des superviseurs, et renforcent la cohérence entre les cadres nationaux.
Par ailleurs, les institutions panafricaines comme la Banque africaine de développement (BAD), l’AFRITAC ou FSD Africa ont un rôle déterminant à jouer pour accompagner cette dynamique. Leur soutien peut se traduire par un appui technique, une assistance à la conception de solutions interopérables, le financement d’études comparatives, ou encore la mise à disposition d’outils mutualisés. Leur capacité à fédérer les énergies, structurer des coalitions d’acteurs et aligner les investissements autour de feuilles de route régionales est un atout majeur.
Enfin, une gouvernance multi-niveaux, associant institutions nationales, régionales et continentales, peut contribuer à éviter la fragmentation des initiatives, à renforcer la souveraineté technologique des États, et à positionner l’Afrique comme une région pilote en matière de supervision numérique inclusive et collaborative.
Recommandations pour aller plus loin
À partir des cas étudiés et des enseignements du terrain, plusieurs recommandations peuvent être formulées à l’attention des autorités africaines désireuses d’accélérer leur transition RegTech et SupTech:
- Construire une stratégie claire adossée à une feuille de route pluriannuelle, avec des objectifs graduels, des indicateurs de succès et des moyens alloués.
- Renforcer la culture data, en investissant dans les systèmes d’information, les compétences internes et les partenariats avec les acteurs tech locaux.
- Déployer des solutions modulaires et interopérables, adaptées au niveau de maturité numérique des institutions supervisées, pour assurer une montée en charge progressive.
- Valoriser les retours d’expérience africains, en favorisant la documentation, le partage de bonnes pratiques et l’évaluation continue des projets en cours.
- Impliquer les acteurs privés et la société civile, pour garantir la pertinence des outils, la protection des données personnelles et l’adhésion des utilisateurs finaux.
Ces orientations visent à construire un écosystème de supervision financière à la fois performant, inclusif et résilient, capable de répondre aux défis systémiques tout en soutenant l’innovation locale.
Des technologies structurantes au service d’une supervision financière souveraine et inclusive
Face à des enjeux de plus en plus complexes – expansion des services financiers numériques, diversification des risques, exigences réglementaires accrues – les autorités africaines de supervision ont engagé une dynamique de transformation ambitieuse. La RegTech et la SupTech constituent, à ce titre, des leviers d’action concrets, dont les effets sont déjà perceptibles dans plusieurs pays.
Les projets recensés montrent que la réussite repose moins sur la sophistication technologique que sur l’adéquation aux besoins, la clarté des objectifs, et la capacité à mobiliser un écosystème cohérent. Le développement progressif de solutions contextuelles, interopérables et évolutives constitue une voie réaliste pour ancrer durablement ces outils dans les pratiques de supervision.
L’enjeu est désormais de passer à l’échelle : pérenniser les initiatives pilotes, formaliser les retours d’expérience, consolider les référentiels communs et mutualiser les ressources au niveau régional. Cela suppose un engagement fort des autorités nationales, un rôle accru des institutions régionales, et une collaboration structurée avec les acteurs privés et les partenaires techniques.
La RegTech et la SupTech ne sont pas une fin en soi, mais des moyens pour renforcer la robustesse, la transparence et l’inclusivité des systèmes financiers. En poursuivant sur cette trajectoire, les pays africains peuvent se doter d’outils de régulation à la hauteur de leurs ambitions : efficaces, adaptables, et porteurs de valeur à long terme pour l’ensemble des parties prenantes.