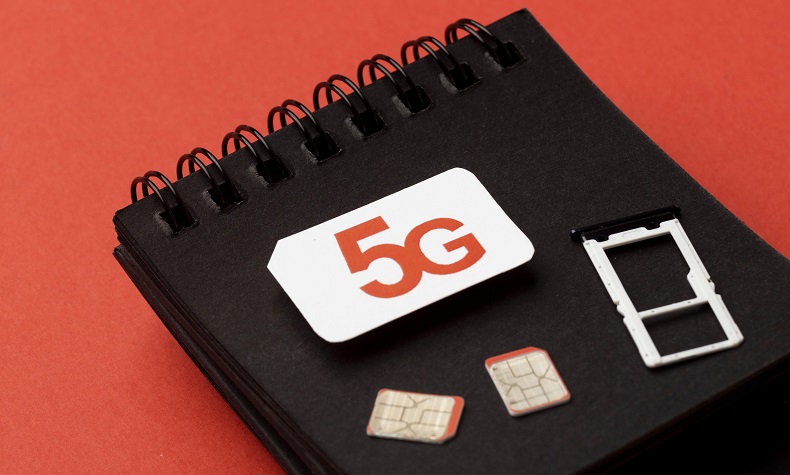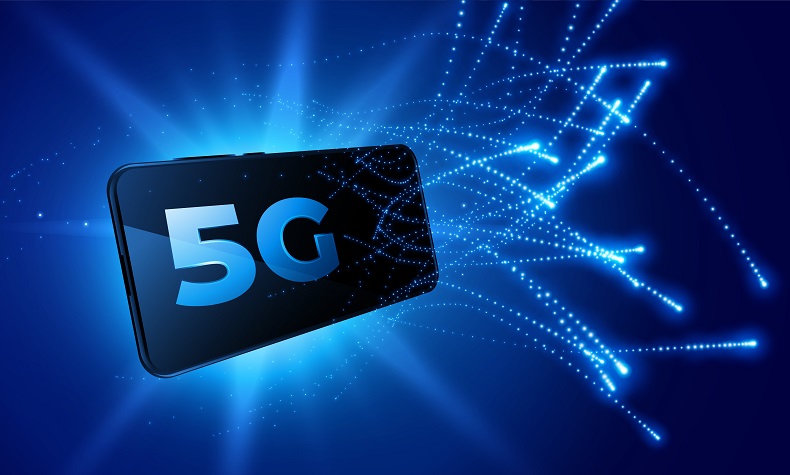Par Jean-Michel Huet, Mohamed Faical Nebri, Nouama Balafrej et Hakim Rharrit, BearingPoint
Le numérique au service de l’administration marocaine
Le Maroc poursuit sa transition vers des services publics numériques, avec l’objectif de simplifier les démarches, améliorer l’accès à l’information et rationaliser les processus. L’intelligence artificielle, en plein essor à l’échelle mondiale, pourrait devenir un outil clé pour accélérer cette transformation. Encore faut-il définir les conditions de son intégration dans l’action publique.
Alors que le pays a posé les fondations d’un État numérique, l’essor rapide de l’intelligence artificielle ouvre de nouvelles perspectives. Il ne s’agit plus seulement d’automatiser les processus existants, mais d’exploiter la capacité de ces technologies à analyser, recommander, alerter ou orienter. Bien intégrée, l’IA peut transformer en profondeur la manière dont l’administration conçoit et délivre ses services – à condition d’en maîtriser les usages et de veiller à ce qu’elle ne creuse pas davantage les inégalités existantes.
Le Maroc face au défi de la continuité dans sa transformation numérique
Depuis quelques années, le Maroc affiche une volonté affirmée de transformer son administration grâce au numérique. Portée par des programmes structurants tels que le Nouveau Modèle de Développement ou la stratégie « Maroc Digital 2030 », cette dynamique a déjà permis de lancer plusieurs plateformes emblématiques et de digitaliser plus de soixante services publics. Dans ce contexte en pleine mutation, l’intelligence artificielle (IA) émerge comme un levier technologique de premier plan, susceptible d’accélérer la mue numérique de l’administration et d’en approfondir l’impact. Mais cette transition pose aussi des questions fondamentales, liées à la gouvernance, à la souveraineté des données et à l’inclusion sociale.
La transformation numérique de l’État marocain s’est construite progressivement autour d’un cadre institutionnel renforcé. Un ministère délégué à la Transition numérique a vu le jour, une feuille de route a été élaborée, et plusieurs textes réglementaires ont été adoptés pour structurer l’action publique en la matière. Parmi les avancées notables figurent la plateforme Idaraty, qui centralise un large éventail de démarches administratives, Chikaya, qui permet aux citoyens de formuler leurs réclamations en ligne, ou encore Chafafiya, dédiée à l’accès à l’information publique. L’identité numérique, quant à elle, facilite un accès sécurisé aux services dématérialisés.
Ces initiatives traduisent une volonté réelle de modernisation. Elles ont permis de rendre les services publics plus accessibles, plus transparents et plus efficaces dans certaines zones. Toutefois, la fracture numérique demeure bien réelle, tant sur le plan social que territorial. L’usage des services en ligne reste faible dans les régions les plus éloignées ou chez les populations les moins alphabétisées. Par ailleurs, l’interopérabilité entre les différents systèmes d’information publics est encore lacunaire, et la simplification des démarches reste souvent superficielle, se limitant à une digitalisation formelle sans repenser les processus sous-jacents.
L’IA, un levier d’innovation pour une administration plus réactive
L’IA permet d’aller au-delà de la simple dématérialisation. Elle ouvre la voie à des logiques prédictives, à la personnalisation des services, et à la détection proactive des anomalies. Elle permet une meilleure allocation des ressources et une anticipation des besoins des usagers.
Côté usager : une expérience réinventée
Les outils d’intelligence artificielle transforment profondément la manière dont les citoyens interagissent avec les services publics. Grâce à des assistants conversationnels, à des suggestions intelligentes ou au pré-remplissage automatisé, les démarches deviennent plus fluides et plus intuitives. Ces dispositifs permettent de limiter les erreurs, d’éviter les allers-retours et de mieux guider l’usager à chaque étape. En Afrique du Sud, par exemple, la plateforme GovChat permet aux citoyens de poser des questions, de signaler des problèmes et d’accéder à des services via une interface de messagerie familière. Ce type d’outil participe à renforcer le lien entre administration et citoyens, en rendant la relation plus directe, plus réactive et plus accessible.
L’accessibilité à l’information en est également simplifiée. L’analyse sémantique et le traitement du langage naturel (NLP) rendent compréhensibles des contenus complexes : conditions d’éligibilité, textes réglementaires, procédures juridiques. Ces outils profitent en particulier aux personnes peu alphabétisées, non francophones ou en situation de handicap, en leur offrant un accès simplifié, voire vocalisé, aux services publics, renforçant ainsi l’inclusion numérique.
Côté administration : fluidité, efficacité, pilotage
L’intelligence artificielle change aussi la donne pour les services publics côté coulisses. L’automatisation des tâches répétitives — telles que le traitement de justificatifs ou la gestion de dossiers standards — libère du temps pour ce qui compte vraiment : accompagner les usagers dans les situations complexes, celles qui requièrent discernement, écoute et capacité d’adaptation.
Mais ce n’est pas qu’une question de gain de temps. Grâce à l’analyse des données, les administrations peuvent mieux comprendre leurs propres fonctionnements. Quels services sont saturés ? Où surgissent les retards ? Quels parcours usagers posent un problème ? L’IA fournit des tableaux de bord dynamiques et intelligents, permettant de piloter les services publics de manière plus fine, plus réactive.
Enfin, l’IA ouvre une perspective ambitieuse : celle d’un service public plus juste et plus proche de ses citoyens. En mobilisant intelligemment les données sociales, géographiques, fiscales ou comportementales, elle permet de mieux orienter les aides, de renforcer l’équité dans l’accès aux droits, et d’identifier ceux que les dispositifs classiques ne parviennent pas à atteindre. Elle devient ainsi un levier de confiance et d’inclusion, au service de politiques publiques universelles.
Santé, éducation, justice… Des applications concrètes dans les services publics clés
C’est dans les usages concrets que l’intelligence artificielle révèle tout son potentiel. Elle peut dès aujourd’hui transformer la manière dont certains services publics fonctionnent au quotidien. Santé, éducation, justice, fiscalité… autant de secteurs confrontés à des défis récurrents où l’IA peut apporter des réponses tangibles : meilleure anticipation, accompagnement plus fin, réduction des inégalités d’accès, transparence renforcée.
Santé : anticiper, désengorger, répartir
Dans un secteur où la pression sur les infrastructures est forte, l’IA offre des réponses concrètes. Elle permet de prédire les pics d’affluence dans les centres de santé, orienter les patients vers les structures les moins engorgées, et mieux répartir les ressources médicales. Elle peut aussi assurer un suivi des stocks de médicaments, anticiper les ruptures et optimiser la chaîne logistique. À plus long terme, l’analyse automatisée des examens médicaux pourrait contribuer à la détection précoce de maladies, à la priorisation des cas urgents, et à l’allègement du travail des professionnels de santé.
Éducation : détecter les risques, personnaliser les parcours
Le potentiel de l’IA dans l’éducation réside dans sa capacité à accompagner chaque élève selon son propre rythme. En analysant les données de notes, de présence ou de contexte familial, elle peut alerter sur des risques de décrochage bien avant qu’ils ne se concrétisent. Elle permet aussi de personnaliser les parcours pédagogiques, d’orienter les élèves vers les filières les plus adaptées, et de renforcer le lien entre élèves, familles et institutions. L’affectation dans les établissements pourrait aussi gagner en transparence et en efficacité grâce à des algorithmes prenant en compte des critères à la fois pédagogiques et géographiques.
Justice : fluidifier l’accès et les traitements
Dans un système souvent perçu comme long et complexe, l’IA peut faciliter l’accès au droit et accélérer les procédures. Elle peut aider à trier les dossiers, à identifier les cas prioritaires ou les redondances, et à proposer des jurisprudences pertinentes aux magistrats. Pour les citoyens, des assistants virtuels peuvent expliquer les procédures, guider vers les bons services ou aider à constituer un dossier complet, rendant la justice plus compréhensible, plus accessible et moins intimidante.
Fiscalité : détecter, sécuriser, hiérarchiser
En Afrique du Sud, les systèmes fiscaux automatisés sont déjà opérationnels. Ils permettent de repérer plus rapidement les erreurs, d’améliorer la conformité et de hiérarchiser les contrôles. L’automatisation intelligente contribue ainsi à une fiscalité plus équitable et plus efficiente. Le Ghana, de son côté, explore actuellement l’usage de l’IA pour détecter des anomalies dans les déclarations fiscales en analysant les données en temps réel, mais les déploiements à grande échelle restent en cours de structuration.
Aides sociales : identifier, cibler, ajuster
Le Togo a amorcé, pendant la crise sanitaire, une expérimentation prometteuse autour de l’utilisation de l’IA pour la distribution rapide et ciblée des aides sociales. En croisant données mobiles, localisation et profils socio-économiques, le programme Novissi visait à identifier les bénéficiaires sans passer par une lourde procédure administrative. Si ce type d’usage reste encore à généraliser, il ouvre la voie à une protection sociale plus agile, capable de répondre aux urgences comme aux besoins structurels. Ce type d’usage ouvre la voie à une protection sociale plus agile, capable de répondre aux urgences comme aux besoins structurels.
Quelles conditions pour une IA publique maîtrisée ?
L’intelligence artificielle dans le secteur public n’est plus une perspective lointaine, mais une réalité qui s’impose progressivement à de nombreux pays, à des rythmes variés. Pour éviter qu’elle n’accentue les inégalités d’accès ou de qualité, il est essentiel d’en poser les bons fondements : gouvernance rigoureuse des données, montée en compétences des agents, cadre d’usage responsable et souci constant de l’usager. Le Maroc, déjà engagé dans plusieurs chantiers de modernisation numérique, doit inscrire ses ambitions en matière d’IA dans cette dynamique, avec rigueur, méthode et vigilance.
Structurer et fiabiliser les données
Pour que l’intelligence artificielle tienne ses promesses dans le secteur public, elle doit s’appuyer sur des données de qualité, bien structurées et interopérables. Cela implique une meilleure coordination entre administrations, l’adoption de standards communs, et une gouvernance claire sur la collecte, le partage et l’usage des données. Sans un tel socle, les algorithmes risquent de produire des résultats biaisés ou inexploitables. Le Maroc doit poursuivre ses efforts en matière de structuration, de normalisation et d’ouverture encadrée des données.
Renforcer les compétences humaines
Le développement de l’intelligence artificielle dans les services publics repose aussi sur la capacité des institutions à faire évoluer les compétences en interne. Il ne s’agit pas uniquement de recruter des experts techniques, mais aussi de former les agents aux usages, aux enjeux et aux limites de ces outils. Cela nécessite une montée en compétence progressive, à tous les niveaux de responsabilité, et un accompagnement adapté pour encourager l’appropriation des outils.
Adopter une gouvernance éthique et souveraine
Le déploiement de l’IA dans les administrations implique des choix structurants en matière de gouvernance. Il faut encadrer le développement et l’usage des algorithmes, garantir la transparence des décisions automatisées, et prévenir les biais potentiels. La localisation des données sensibles, la maîtrise des outils critiques et la capacité à auditer les systèmes sont des éléments clés pour garantir la souveraineté numérique et la confiance dans les services.
Rester centré sur l’usager
Les outils d’intelligence artificielle doivent s’adapter aux réalités des citoyens, et non l’inverse. Ils doivent faciliter les démarches, sans les complexifier et sans exclure les publics les plus vulnérables. Cela suppose de concevoir les services de manière inclusive, de maintenir des alternatives humaines accessibles, et d’intégrer des phases de test en conditions réelles. Le langage, le niveau d’alphabétisation, les habitudes numériques ou les contraintes de connectivité doivent être pris en compte dès la conception des outils.
L’IA, un outil puissant à manier avec discernement
L’intelligence artificielle offre au Maroc une opportunité inédite de franchir un nouveau cap dans la modernisation de ses services publics. Elle ne remplace pas les politiques publiques, mais les prolonge et les affine, en rendant possible une administration plus agile, plus proactive et plus proche des réalités du terrain. Sa mise en œuvre demande méthode, anticipation et vigilance. À condition d’être bien encadrée, alignée avec les priorités nationales et pensée dès sa conception comme un outil au service de l’intérêt général, l’IA peut devenir un catalyseur puissant d’un service public plus efficace, plus équitable et plus inclusif.